Depuis plus de vingt ans, le web a connu plusieurs révolutions. La première version, souvent appelée Web1, se résumait à des pages statiques : on consultait l’information, sans vraiment interagir. Puis est arrivé le Web2, celui que nous connaissons aujourd’hui. Ce web social et dynamique a rendu les internautes acteurs : ils créent, commentent, partagent, publient. Facebook, YouTube ou encore WordPress en sont des symboles.
Mais une nouvelle mutation est en marche : le Web3. Ce mot est sur toutes les lèvres, souvent associé aux cryptomonnaies, aux NFT ou à la blockchain. Pourtant, le Web3 ne se limite pas à ces aspects techniques. Il représente une nouvelle façon d’utiliser Internet, plus libre, plus transparente et plus équitable.
L’objectif de ce chapitre du tutoriel complet sur le web3 est de vous expliquer, étape par étape, comment un site web classique peut tirer parti du Web3 sans devoir tout reconstruire. Vous découvrirez des cas concrets d’intégration, comme la vérification d’identité via un portefeuille numérique, les micro-paiements automatisés pour rémunérer du contenu, ou encore la gestion d’une identité numérique décentralisée.
Même si ces notions peuvent sembler techniques, nous allons les aborder de manière simple et progressive, sans jargon inutile. À la fin de cette lecture, vous comprendrez comment relier le monde des sites Web traditionnels au nouvel écosystème du Web3, en gardant la maîtrise de vos outils et de votre stratégie.
- Comprendre les fondements du Web3
- Intégrer la vérification Web3 dans un site classique
- Les micro-paiements Web3 pour les contenus en ligne
- Le principe des micro-paiements Web3
- Pourquoi adopter les micro-paiements sur un site classique ?
- Comment fonctionnent les micro-paiements techniques
- Cas concret : un blog avec des articles payés à la lecture
- Le rôle des stablecoins : simplifier les micro-paiements
- Les micro-paiements et les smart contracts : un duo puissant
- Comment intégrer ces paiements à un site déjà existant
- Étude de cas : un site de tutoriels qui récompense ses auteurs
- Pourquoi les micro-paiements sont l’avenir du web
- L’identité numérique et la réputation sur le Web3
- Les avantages d’une identité numérique sur le Web3
- Cas concret : un utilisateur qui conserve son profil et ses certificats sur la blockchain
- Comment un site web classique peut interagir avec cette identité
- La réputation numérique : un nouvel enjeu pour la confiance en ligne
- Comment exploiter cette réputation sur un site classique
- L’avenir de l’identité numérique dans le Web3
- Les limites et les défis d’une intégration Web3
- Web3 et sites web classiques, une révolution à portée de main
Comprendre les fondements du Web3
Avant de parler d’intégration concrète, il est essentiel de comprendre ce qu’est réellement le Web3. Car il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle technologie : c’est un changement profond de philosophie dans la manière dont les données, les identités et les transactions circulent sur Internet.
Le Web3, c’est quoi exactement ?
Le Web3 est une évolution du web basée sur la décentralisation. Cela signifie qu’au lieu de reposer sur des serveurs centralisés (comme ceux d’Amazon, Google ou Facebook), les données sont stockées et vérifiées par un réseau distribué d’ordinateurs, appelés nœuds. Ces nœuds utilisent la blockchain, une technologie qui enregistre les informations de manière transparente et infalsifiable.
L’une des grandes différences entre le Web2 et le Web3 réside dans la notion de propriété numérique. Sur le Web2, vos données, vos photos, vos messages et vos créations appartiennent souvent aux plateformes qui les hébergent. Sur le Web3, grâce à la blockchain, vous êtes propriétaire de vos données. Vous pouvez les déplacer, les protéger, ou les partager à votre guise.
Pour comprendre cela, imaginez une boîte aux lettres numérique. Dans le Web2, elle se trouve chez une entreprise qui peut décider un jour de vous la retirer. Dans le Web3, cette boîte vous appartient et personne ne peut en changer le contenu sans votre accord.
Du Web2 au Web3 : une différence de logique
Dans le Web2, les utilisateurs se connectent via un nom d’utilisateur et un mot de passe. Ces informations sont stockées sur un serveur central. Si le serveur est piraté, les comptes le sont aussi. De plus, vous devez répéter cette opération pour chaque site, multipliant les risques de fuite.
Dans le Web3, la connexion se fait grâce à un wallet (ou portefeuille numérique), comme MetaMask, Phantom ou Rainbow. Ce wallet ne contient pas vos données, mais une clé cryptographique unique qui prouve que vous êtes bien le propriétaire de votre identité numérique. Vous pouvez donc vous connecter à n’importe quel site compatible sans créer de nouveau compte.
Ainsi, le Web3 ne vise pas à remplacer totalement le Web2, mais à l’enrichir. Il apporte une nouvelle couche de confiance, de transparence et de sécurité au web que nous utilisons déjà.
La blockchain : le moteur du Web3
Pour bien comprendre comment tout cela fonctionne, il faut s’arrêter un instant sur le rôle de la blockchain.
Une blockchain est une base de données partagée entre de nombreux ordinateurs. Chaque fois qu’une transaction est effectuée, elle est enregistrée dans un bloc, puis ajoutée à la chaîne existante après vérification par le réseau. Une fois inscrit, un bloc ne peut plus être modifié.
Cette immuabilité est la clé de la confiance dans le Web3. Par exemple, lorsqu’un paiement est effectué sur une blockchain, il est visible publiquement, vérifiable, et ne peut pas être falsifié.
Il existe plusieurs blockchains, chacune avec ses particularités :
- Ethereum, la plus connue, qui permet d’exécuter des contrats intelligents (smart contracts).
- Polygon, une version plus rapide et moins coûteuse, compatible avec Ethereum.
- Solana, orientée vers la performance et les transactions instantanées.
- Bitcoin, qui reste centrée sur la valeur monétaire.
Cas concret : un site de streaming qui adopte le Web3
Prenons un exemple simple pour comprendre comment un site classique peut utiliser le Web3.
Imaginez un site de streaming musical. Aujourd’hui, les artistes y sont rémunérés au nombre d’écoutes, mais les paiements passent par des intermédiaires : plateformes, labels, banques. Le créateur ne reçoit qu’une petite part du revenu généré.
En adoptant le Web3, ce site pourrait proposer un modèle de paiement direct entre l’auditeur et l’artiste. Chaque fois qu’un utilisateur écoute un morceau, un micro-paiement en crypto-monnaie est envoyé automatiquement au portefeuille de l’artiste via un smart contract. Aucun intermédiaire, aucun retard de paiement, aucune commission cachée.
L’utilisateur garde le contrôle sur ses données (il n’a pas besoin de créer un compte classique), et l’artiste reçoit immédiatement sa part. Ce système repose sur la même logique que la blockchain : transparence et automatisation.
C’est un exemple simple, mais il montre déjà comment le Web3 peut améliorer des services existants sans les remplacer.
Les atouts majeurs du Web3 pour les sites web
Le Web3 apporte plusieurs bénéfices directs à un site Internet :
- La confiance : les utilisateurs peuvent vérifier eux-mêmes les transactions ou les informations, sans devoir se fier aveuglément à une entreprise.
- La sécurité : les identités numériques sont protégées par des clés cryptographiques uniques.
- L’autonomie : les développeurs et les utilisateurs ne dépendent plus d’une plateforme centralisée pour faire fonctionner leur site.
- La traçabilité : chaque action est enregistrée et consultable sur la blockchain.
Ces éléments deviennent essentiels dans un contexte où les internautes exigent plus de transparence, et où les scandales liés à la vie privée se multiplient.
Le Web3, une opportunité pour les sites classiques
De nombreux propriétaires de sites hésitent à franchir le pas, pensant que le Web3 est réservé aux experts en cryptomonnaie. En réalité, il est tout à fait possible de combiner des technologies Web2 et Web3 pour créer une expérience hybride.
Un site WordPress, un forum PHP, ou même une boutique en ligne peuvent intégrer des fonctions Web3 de manière progressive. Par exemple :
- ajouter un système de connexion via wallet plutôt qu’un mot de passe,
- proposer un micro-paiement automatique pour un contenu premium,
- afficher des badges vérifiés basés sur l’identité décentralisée d’un utilisateur.
Dans les chapitres suivants, nous verrons comment ces intégrations se font concrètement, avec des exemples clairs et accessibles à tout développeur ou propriétaire de site.
Mais avant de plonger dans le code et les solutions pratiques, retenons une idée clé : le Web3 n’est pas une mode passagère. C’est la prochaine étape logique du web, celle où la technologie permet enfin de rendre le pouvoir aux utilisateurs, tout en offrant aux sites une nouvelle manière d’interagir, de monétiser et de fidéliser leur audience.
Intégrer la vérification Web3 dans un site classique
Le premier pas vers l’adoption du Web3 dans un site Internet traditionnel consiste souvent à remplacer le système de connexion classique (adresse e-mail + mot de passe) par une authentification décentralisée.
Cette méthode ne repose plus sur un serveur central ni sur des identifiants stockés dans une base de données. À la place, elle utilise la signature cryptographique d’un portefeuille numérique (ou wallet) comme preuve d’identité.
Voyons ensemble comment cela fonctionne, pourquoi c’est plus sûr, et comment l’intégrer concrètement à un site déjà existant.
Pourquoi la vérification Web3 change la donne
Dans le Web2, la vérification d’un utilisateur repose sur des données sensibles : adresse e-mail, mot de passe, parfois numéro de téléphone. Ces données sont enregistrées sur un serveur, souvent en clair ou mal protégées.
Cela explique pourquoi tant de sites subissent des fuites de données : dès qu’un pirate accède à la base, il obtient les comptes de milliers d’utilisateurs.
Avec le Web3, cette logique change complètement. L’utilisateur ne confie plus ses informations à un site, il prouve simplement qu’il est le détenteur d’une clé privée grâce à une signature numérique. Autrement dit, il n’a plus besoin de créer un compte ni de retenir un mot de passe. Il lui suffit d’utiliser son wallet, une extension ou une application mobile qu’il contrôle lui-même.
Le site, de son côté, ne stocke aucune donnée sensible. Il vérifie simplement que la signature fournie correspond bien à l’adresse publique du wallet.
Ce processus rend la connexion instantanée, sécurisée et anonyme :
- aucune base de données de mots de passe à gérer,
- aucun risque de vol d’identité via phishing,
- aucune dépendance à un fournisseur tiers (comme Google ou Facebook).
Comprendre la signature numérique avec un wallet
Lorsqu’un utilisateur se connecte avec son wallet, voici ce qui se passe concrètement :
- Le site envoie un message aléatoire (appelé nonce) au navigateur de l’utilisateur.
- Le wallet de l’utilisateur demande à signer ce message avec sa clé privée.
- La signature est renvoyée au site.
- Le site vérifie que cette signature correspond bien à la clé publique du wallet (c’est-à-dire à son adresse).
Si la signature est valide, l’utilisateur est considéré comme authentifié. Il n’a jamais révélé sa clé privée ni transmis d’information personnelle.
C’est un peu comme si vous signiez un document officiel avec un sceau personnel que seul vous possédez. Le sceau prouve votre identité sans dévoiler ce qu’il contient.
Cette méthode est utilisée par toutes les grandes applications Web3 : OpenSea, Uniswap, Lens Protocol ou Mirror. Et bonne nouvelle : vous pouvez l’implémenter vous aussi, même sur un site PHP classique.
Cas concret : permettre la connexion avec un wallet sur un site PHP
Prenons un exemple simple. Imaginons que vous gériez un site de formation ou un blog, et que vous souhaitiez permettre à vos visiteurs de se connecter grâce à leur wallet MetaMask au lieu de leur adresse e-mail.
Voici comment procéder pas à pas.
Étape 1 : Ajouter le script Web3.js
Pour dialoguer avec un portefeuille comme MetaMask, il faut inclure la bibliothèque Web3.js dans votre site. Elle permet au navigateur d’interagir avec la blockchain via le wallet installé de l’utilisateur.
Dans votre fichier HTML ou PHP, ajoutez ce script avant la fermeture de la balise <body> :
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/web3@latest/dist/web3.min.js"></script>Étape 2 : Détecter la présence de MetaMask
Une fois la bibliothèque chargée, vous pouvez vérifier si MetaMask est installé dans le navigateur.
<script>
if (typeof window.ethereum !== 'undefined') {
console.log("MetaMask est détecté !");
} else {
alert("Veuillez installer MetaMask pour continuer.");
}
</script>Cela garantit que votre site ne proposera la connexion Web3 qu’aux utilisateurs équipés d’un wallet.
Étape 3 : Demander la connexion au wallet
Lorsque l’utilisateur clique sur un bouton “Se connecter avec MetaMask”, on appelle la méthode suivante :
<script>
async function connectWallet() {
const accounts = await window.ethereum.request({ method: 'eth_requestAccounts' });
const userAddress = accounts[0];
console.log("Adresse du wallet :", userAddress);
}
</script>
<button onclick="connectWallet()">Se connecter avec MetaMask</button>Cette action ouvre une fenêtre MetaMask demandant à l’utilisateur d’autoriser votre site à connaître son adresse publique.
Étape 4 : Signer un message pour prouver son identité
Pour éviter qu’un visiteur ne prétende être quelqu’un d’autre, il faut qu’il signe un message.
Le site envoie une chaîne aléatoire (le nonce), et le wallet la signe.
<script>
async function signMessage() {
const web3 = new Web3(window.ethereum);
const accounts = await web3.eth.getAccounts();
const userAddress = accounts[0];
const nonce = Math.floor(Math.random() * 1000000).toString();
const signature = await web3.eth.personal.sign("Connexion sécurisée : " + nonce, userAddress, "");
console.log("Signature :", signature);
// Vous pouvez ensuite envoyer cette signature à votre serveur PHP pour vérification
fetch('verifier_signature.php', {
method: 'POST',
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({ address: userAddress, signature: signature, nonce: nonce })
});
}
</script>
<button onclick="signMessage()">Signer pour se connecter</button>Étape 5 : Vérifier la signature côté serveur PHP
Sur le serveur, vous pouvez utiliser une librairie comme phpseclib ou Elliptic Curve PHP pour vérifier que la signature correspond bien à l’adresse publique.
Voici un exemple simplifié du fichier verifier_signature.php :
<?php
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
$address = $data['address'];
$signature = $data['signature'];
$nonce = $data['nonce'];
// Ici, on utiliserait une fonction Web3 spécifique pour vérifier la signature
// En pratique, vous pouvez appeler un service externe ou un script Node.js pour cela
$isValid = true; // Supposons que la vérification est réussie
if ($isValid) {
session_start();
$_SESSION['user_wallet'] = $address;
echo json_encode(["status" => "ok", "message" => "Connexion réussie"]);
} else {
echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Signature invalide"]);
}Une fois validé, l’utilisateur est reconnu comme connecté. Vous pouvez stocker son adresse dans une session et lui donner accès à son espace personnel comme vous le feriez avec un utilisateur classique.
Avantages pour votre site et vos utilisateurs
Ce système d’authentification décentralisée présente plusieurs atouts évidents.
D’abord, il renforce la sécurité : aucun mot de passe n’est enregistré, donc aucun risque de fuite.
Ensuite, il simplifie l’expérience utilisateur : plus besoin de formulaire d’inscription ni d’e-mail de confirmation.
Enfin, il ouvre la porte à de nouvelles fonctionnalités Web3, comme la gestion de badges sur la blockchain, la participation à des votes communautaires ou l’accès à des contenus réservés selon le portefeuille possédé.
De plus, cette méthode est universelle. Un utilisateur connecté sur votre site via son wallet pourra aussi s’authentifier de la même manière sur d’autres sites compatibles. Vous contribuez ainsi à la création d’une identité numérique fluide, contrôlée par l’utilisateur lui-même.
Cas d’usage : la vérification d’un certificat sur un site éducatif
Prenons un exemple concret.
Imaginons que vous gériez un site de formation en ligne. Vous délivrez des certificats à vos élèves une fois leurs exercices terminés.
Aujourd’hui, ces certificats sont souvent de simples fichiers PDF stockés sur un serveur. Rien n’empêche quelqu’un d’en modifier le contenu pour tricher.
En adoptant le Web3, vous pouvez vérifier l’identité de l’élève via son wallet avant de générer le certificat. Ensuite, vous pouvez inscrire la preuve de réussite sur la blockchain, de manière infalsifiable.
Ainsi, lorsqu’un employeur ou un organisme externe souhaite vérifier la validité d’un diplôme, il lui suffit de consulter l’enregistrement sur la blockchain pour confirmer qu’il est authentique.
Cette combinaison entre authentification Web3 et preuve décentralisée transforme la manière dont les sites éducatifs gèrent leurs données. Elle offre une confiance totale sans intermédiaire.
Une technologie déjà prête
La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin de tout réécrire pour ajouter cette fonctionnalité à votre site.
Des bibliothèques open source comme Web3Modal, Ethers.js ou Moralis Auth facilitent grandement cette intégration, que votre site soit en PHP, Node.js, ou même sous WordPress.
De nombreux projets hybrides (mi Web2, mi Web3) émergent déjà :
- des sites e-commerce où les utilisateurs se connectent avec leur wallet,
- des plateformes communautaires où les rôles sont attribués selon les tokens détenus,
- des forums où les utilisateurs sont identifiés par leur adresse blockchain plutôt que par une adresse mail.
Ces innovations montrent que la vérification Web3 n’est pas une théorie, mais une solution pratique, accessible et déjà en usage dans de nombreux secteurs.
Les micro-paiements Web3 pour les contenus en ligne
Le modèle économique du Web2 repose essentiellement sur deux piliers : la publicité et les abonnements. Ce système fonctionne, mais il présente de nombreuses limites : dépendance à des plateformes externes, frais élevés, collecte de données personnelles et rémunération souvent inéquitable pour les créateurs.
Le Web3 apporte une alternative élégante : les micro-paiements décentralisés. Grâce à la blockchain et aux cryptomonnaies, il devient possible de rémunérer instantanément un auteur, un musicien ou un enseignant pour quelques centimes d’euros… sans passer par un intermédiaire.
Voyons comment cela fonctionne, pourquoi c’est intéressant pour un site classique, et comment le mettre en place concrètement.
Le principe des micro-paiements Web3
Dans le Web3, un paiement n’a pas besoin de passer par une banque ou une passerelle traditionnelle comme Stripe ou PayPal. Il se fait directement d’un utilisateur à un autre, via la blockchain.
Cette transaction peut être programmée, automatisée et surtout minime : quelques centimes suffisent.
Les micro-paiements permettent par exemple :
- de rémunérer un auteur à la lecture d’un article,
- de soutenir un créateur à chaque écoute d’une chanson,
- de payer l’accès à une ressource spécifique sans souscrire d’abonnement.
La blockchain rend cela possible grâce aux smart contracts, des petits programmes autonomes qui exécutent des instructions dès qu’une condition est remplie. Par exemple : « si l’utilisateur A envoie 0,001 MATIC, alors il peut lire l’article ».
Ce modèle évite les frais bancaires, les délais de virement, et réduit la dépendance à des géants du paiement.
Pourquoi adopter les micro-paiements sur un site classique ?
Pour un site web traditionnel, adopter les micro-paiements Web3 peut apporter plusieurs bénéfices concrets.
D’abord, c’est une manière simple et équitable de monétiser du contenu. Plutôt que d’imposer un abonnement mensuel, vous laissez vos visiteurs choisir : payer uniquement ce qu’ils consomment.
Ensuite, c’est plus transparent : chaque transaction est inscrite sur la blockchain, vérifiable par les deux parties.
Enfin, c’est rapide et international : un visiteur situé à l’autre bout du monde peut payer en quelques secondes, sans contrainte de devise.
De plus, les micro-paiements favorisent un lien direct entre créateurs et utilisateurs, sans intermédiaire. C’est exactement l’esprit du Web3 : redonner le contrôle à ceux qui produisent et à ceux qui consomment.
Comment fonctionnent les micro-paiements techniques
Pour mieux comprendre, imaginons le processus complet d’un micro-paiement Web3 sur un site classique :
- L’utilisateur se connecte avec son wallet, comme vu au chapitre précédent.
- Le site affiche un bouton « Lire cet article pour 0,01 MATIC ».
- Lorsque l’utilisateur clique, son wallet s’ouvre et propose de confirmer le paiement.
- Le smart contract reçoit la transaction, vérifie le montant, et débloque le contenu.
- L’auteur reçoit instantanément la somme sur son propre portefeuille.
Tout se passe automatiquement. Aucun traitement manuel, aucune facture à générer, aucun délai.
Le rôle du site est simplement de déclencher la transaction et de vérifier sa réussite avant de délivrer le contenu.
Cas concret : un blog avec des articles payés à la lecture
Prenons l’exemple d’un blog professionnel qui publie des articles de fond.
Actuellement, vous affichez de la publicité pour financer le site. Mais cela réduit la lisibilité, ralentit le chargement des pages et ne rapporte souvent que quelques euros pour des milliers de vues.
Avec le Web3, vous pouvez proposer un système alternatif :
le lecteur paie 0,01 € en crypto (soit environ 0,0005 MATIC) pour accéder à un article complet.
Voici comment cela peut fonctionner techniquement.
Étape 1 : le smart contract
Vous créez un petit smart contract sur le réseau Polygon (moins cher que Ethereum).
Son rôle est simple :
- recevoir un paiement,
- vérifier que le montant est suffisant,
- envoyer un signal au site indiquant que le paiement a été validé.
Un exemple en pseudo-code :
// Contrat simplifié pour micro-paiement d'article
pragma solidity ^0.8.0;
contract PayPerRead {
address public owner;
uint256 public price = 1000000000000000; // 0.001 MATIC
constructor() {
owner = msg.sender;
}
function payForArticle() public payable {
require(msg.value >= price, "Montant insuffisant");
payable(owner).transfer(msg.value);
}
}Ce code peut être déployé sur la blockchain grâce à des outils comme Remix ou Hardhat.
Une fois le contrat en ligne, il possède sa propre adresse publique.
Étape 2 : le bouton de paiement sur le site
Dans votre site PHP ou HTML, vous ajoutez un bouton qui appelle ce contrat via Web3.js.
<button onclick="payArticle()">Payer et lire l'article</button>
<script>
async function payArticle() {
const web3 = new Web3(window.ethereum);
const contractAddress = "ADRESSE_DU_CONTRAT";
const abi = [/* ABI du contrat ici */];
const contract = new web3.eth.Contract(abi, contractAddress);
const accounts = await web3.eth.requestAccounts();
await contract.methods.payForArticle().send({
from: accounts[0],
value: web3.utils.toWei('0.001', 'ether')
});
document.getElementById('contenu').style.display = 'block';
}
</script>L’utilisateur confirme la transaction dans son wallet. Dès qu’elle est validée, le contenu devient visible.
Étape 3 : l’expérience utilisateur
L’expérience reste fluide.
L’utilisateur n’a pas besoin de créer un compte ni de renseigner ses coordonnées bancaires.
Le paiement est effectué directement depuis son portefeuille, en quelques secondes.
Et comme les frais sur les réseaux modernes comme Polygon ou Arbitrum sont très faibles, le coût total reste inférieur à un centime.
Le rôle des stablecoins : simplifier les micro-paiements
L’un des obstacles aux paiements Web3 reste la volatilité des cryptomonnaies.
Pour contourner ce problème, de nombreux projets utilisent des stablecoins, c’est-à-dire des cryptos dont la valeur reste stable par rapport à une monnaie classique, comme l’euro ou le dollar.
Des exemples :

Des formations informatique pour tous !
Débutant ou curieux ? Apprenez le développement web, le référencement, le webmarketing, la bureautique, à maîtriser vos appareils Apple et bien plus encore…
Formateur indépendant, professionnel du web depuis 2006, je vous accompagne pas à pas et en cours particulier, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez progresser. En visio, à votre rythme, et toujours avec pédagogie.
Découvrez mes formations Qui suis-je ?- USDC : adossé au dollar, largement utilisé sur Ethereum et Polygon.
- DAI : stablecoin décentralisé, garanti par des collatéraux.
- EURe : stablecoin européen indexé sur l’euro.
En acceptant des stablecoins, votre site peut facturer 0,10 € ou 1 € en valeur réelle, sans subir les fluctuations des marchés.
Cela rend les micro-paiements prévisibles et professionnels, même pour les utilisateurs non familiers des cryptomonnaies.
Les micro-paiements et les smart contracts : un duo puissant
Les micro-paiements prennent toute leur valeur lorsqu’ils s’appuient sur des smart contracts intelligents.
Ces contrats peuvent gérer automatiquement :
- la redistribution de revenus entre plusieurs auteurs ;
- le déclenchement d’un accès temporaire ;
- la facturation à la consommation (par exemple : chaque minute de vidéo).
Exemple concret : un site de streaming éducatif.
Lorsqu’un utilisateur visionne une vidéo, le smart contract verse automatiquement 70 % du paiement au créateur, 20 % à la plateforme, et 10 % à un fonds communautaire.
Tout cela se déroule sans intervention humaine, ni risque d’erreur comptable.
C’est cette automatisation qui fait du Web3 un outil redoutablement efficace pour les micro-transactions.
Comment intégrer ces paiements à un site déjà existant
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas nécessaire de tout reconstruire pour intégrer le Web3.
Vous pouvez ajouter une passerelle Web3 à votre site PHP ou WordPress existant.
Voici quelques approches :
- Utiliser un service d’API comme Coinbase Commerce ou BitPay, qui propose déjà des paiements crypto simples à intégrer, tout en gardant le contrôle des fonds.
- Déployer votre propre smart contract si vous voulez un système plus personnalisé et décentralisé.
- Combiner les deux approches, par exemple : accepter les paiements via un contrat intelligent, mais afficher les confirmations via une API classique.
Dans tous les cas, le principe reste le même :
le site reçoit une preuve de paiement (transaction blockchain), vérifie son authenticité, et débloque le contenu.
Étude de cas : un site de tutoriels qui récompense ses auteurs
Imaginons un site communautaire qui publie des tutoriels, un peu comme OpenClassrooms.
Chaque auteur reçoit un micro-paiement automatique à chaque lecture complète de son article.
Chaque fois qu’un utilisateur clique sur “Lire la suite”, il paie 0,05 USDC.
Le smart contract répartit automatiquement :
- 0,04 USDC à l’auteur,
- 0,01 USDC à la plateforme.
Résultat :
les créateurs sont rémunérés à la performance réelle, les utilisateurs paient seulement ce qu’ils consomment, et la plateforme ne dépend plus d’annonceurs externes.
Ce modèle économique devient possible grâce à la transparence du Web3.
Pourquoi les micro-paiements sont l’avenir du web
Le Web3 ouvre la voie à un nouvel Internet de la valeur.
Chaque clic, chaque visionnage, chaque interaction peut devenir une transaction vérifiable et équitable.
Ce modèle est particulièrement adapté aux créateurs indépendants, aux journalistes, aux formateurs ou aux artistes.
Dans un monde où l’attention devient rare, le Web3 permet de monétiser cette attention sans compromettre la vie privée ni imposer la publicité intrusive.
Et comme tout est automatisé, les sites peuvent fonctionner à moindre coût, sans lourdes infrastructures ni gestion administrative complexe.
L’identité numérique et la réputation sur le Web3
Sur le Web2, l’identité numérique repose sur des comptes et des mots de passe gérés par des plateformes centrales : Google, Facebook, ou encore Apple. Lorsqu’un utilisateur souhaite accéder à un site, il s’identifie à l’aide de ces services ou via une base de données propre au site. Cette méthode, bien que pratique, a un inconvénient majeur : les données d’identité sont stockées sur des serveurs centralisés et peuvent être exploitées, revendues ou piratées.
Le Web3, au contraire, repose sur une approche appelée identité décentralisée, souvent abrégée en DID (Decentralized Identifier). Dans ce modèle, l’utilisateur contrôle lui-même ses informations d’identité grâce à la blockchain et à des portefeuilles numériques (wallets). Ces derniers ne servent pas uniquement à stocker de la cryptomonnaie : ils deviennent une véritable carte d’identité numérique, indépendante de toute entreprise.
Concrètement, une identité décentralisée est composée de trois éléments :
- Un identifiant unique (comme une adresse blockchain, ex : 0x123…abc).
- Des preuves de propriété (par exemple une signature cryptographique permettant de prouver que vous êtes bien le détenteur de cet identifiant).
- Des informations vérifiables (certificats, diplômes, badges, historiques de transaction, réputation).
Ainsi, au lieu de confier ses données personnelles à un site web, l’utilisateur vient avec son identité numérique portable, qu’il contrôle entièrement.
Les avantages d’une identité numérique sur le Web3
Cette nouvelle approche change profondément la relation entre les utilisateurs et les sites web.
L’identité décentralisée présente plusieurs avantages majeurs.
D’abord, elle renforce la sécurité. Il n’y a plus besoin de créer de mot de passe ni de confier son email à un site inconnu. L’utilisateur prouve simplement son identité en signant une requête avec son portefeuille Web3. Cela élimine de nombreux risques de piratage, de phishing ou de vol de données.
Ensuite, elle protège la vie privée. Avec une DID, vous pouvez choisir quelles informations partager, quand et avec qui. Par exemple, un utilisateur peut prouver qu’il a plus de 18 ans sans révéler sa date de naissance, ou prouver qu’il possède un certain diplôme sans dévoiler l’établissement exact. Ce concept repose sur ce que l’on appelle les preuves à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge Proofs, ou ZKP).
Enfin, l’identité décentralisée simplifie la connexion entre différents services. Grâce à la blockchain, il devient possible d’utiliser le même profil sur plusieurs sites, sans créer un nouveau compte à chaque fois. C’est un peu l’équivalent d’un « Login with Google », mais sans intermédiaire, sans collecte de données et sans dépendance à une entreprise tierce.
Cas concret : un utilisateur qui conserve son profil et ses certificats sur la blockchain
Prenons un exemple concret pour illustrer cette idée.
Imaginez un site de formation en ligne, comme code.crea-troyes.fr, qui souhaite délivrer des certificats de réussite à ses apprenants. Dans le Web2, ces certificats sont généralement stockés dans une base de données interne, ou envoyés par email sous forme de PDF.
Mais dans le Web3, ces certificats peuvent être enregistrés sur la blockchain, sous la forme de badges numériques vérifiables. L’utilisateur, grâce à son portefeuille Web3, peut les conserver à vie, indépendamment du site qui les a délivrés.
Ainsi, lorsqu’il se connecte sur un autre site — par exemple une plateforme d’emploi, un réseau professionnel ou un autre service d’apprentissage — il peut prouver instantanément ses compétences sans devoir refaire tout le processus d’inscription ou d’envoi de documents.
Le site web, de son côté, n’a plus besoin de gérer les certificats, ni de vérifier leur authenticité : tout est inscrit de manière infalsifiable sur la blockchain. Cela réduit les coûts, améliore la confiance et simplifie la maintenance.
C’est une révolution pour le monde de la formation, mais aussi pour les secteurs de l’emploi, de la santé ou du commerce en ligne.
Comment un site web classique peut interagir avec cette identité
L’une des forces du Web3, c’est qu’il n’est pas nécessaire de reconstruire entièrement son site pour en bénéficier. Un site web classique peut très bien ajouter une couche Web3 en intégrant des bibliothèques existantes.
Pour permettre à un utilisateur de se connecter avec son identité décentralisée, le développeur peut intégrer des outils tels que Web3.js, Ethers.js, ou des solutions prêtes à l’emploi comme WalletConnect ou Web3Auth. Ces outils permettent d’interagir avec les portefeuilles numériques des utilisateurs, sans qu’ils aient besoin de créer un compte traditionnel.
Voici comment cela fonctionne, de manière simplifiée :
- L’utilisateur clique sur un bouton « Se connecter avec Web3 ».
- Son portefeuille (comme MetaMask) s’ouvre et lui demande de signer une requête.
- Le site vérifie la signature, ce qui prouve que l’utilisateur contrôle bien l’adresse blockchain associée.
- Une session s’ouvre côté serveur, comme pour un login classique.
Ce processus ne nécessite ni mot de passe, ni stockage de données sensibles. Le site ne retient qu’un identifiant unique (l’adresse publique) pour gérer les interactions avec l’utilisateur.
En complément, des services comme Ceramic, ENS (Ethereum Name Service) ou Lens Protocol permettent d’enrichir cette identité décentralisée avec des métadonnées : pseudo, biographie, image de profil, réputation ou historique de participation à des communautés.
La réputation numérique : un nouvel enjeu pour la confiance en ligne
Sur le Web2, la réputation d’un utilisateur repose souvent sur des avis centralisés (notes sur un site d’e-commerce, évaluations sur une plateforme). Ces systèmes, bien que utiles, sont facilement manipulables. Il suffit de quelques faux avis pour fausser la perception de la qualité d’un produit ou d’un service.
Le Web3 propose une approche différente : une réputation basée sur les actions réelles et vérifiables d’un utilisateur sur la blockchain. Chaque interaction — participation à un projet, contribution à un code open source, réussite d’un challenge ou achat d’un NFT — peut être inscrite de manière transparente et consultable.
Prenons un exemple concret. Sur un site communautaire de développeurs, chaque fois qu’un membre aide un autre utilisateur, résout un bug ou publie un code validé par la communauté, il reçoit un badge Web3 enregistré sur la blockchain. Ce badge devient une preuve permanente de sa contribution.
De cette manière, la réputation ne dépend plus d’un simple score géré par une entreprise, mais d’un ensemble de preuves décentralisées. Cette approche ouvre la voie à un internet de la confiance, où la valeur d’un utilisateur ou d’une marque ne se mesure plus uniquement en « likes » ou en « followers », mais en réalisations vérifiables et transparentes.
Comment exploiter cette réputation sur un site classique
Un site web traditionnel peut tirer parti de cette réputation en connectant les profils utilisateurs à leur adresse blockchain.
Par exemple, un forum peut afficher automatiquement les badges ou les certificats détenus par un membre, en lisant les données disponibles sur la blockchain.
Imaginons un blog collaboratif : plutôt que de valider manuellement les auteurs, l’administrateur du site peut exiger que seuls les détenteurs d’un badge “Auteur vérifié” (émis sur la blockchain par une autorité de confiance) puissent publier des articles.
Cette approche réduit les fraudes, simplifie la modération et renforce la crédibilité du contenu. Les utilisateurs gagnent ainsi la possibilité de transporter leur réputation d’un site à un autre, sans dépendre d’un compte centralisé.
De plus, cela permet de bâtir des écosystèmes interconnectés : un utilisateur actif sur un site Web3 peut bénéficier d’avantages, de réductions ou d’un statut spécial sur un autre site participant au même réseau de confiance.
L’avenir de l’identité numérique dans le Web3
L’identité et la réputation décentralisées sont encore à leurs débuts, mais leur potentiel est immense.
De grands projets comme Worldcoin, Polygon ID, Lens Protocol ou SpruceID travaillent déjà à la création d’infrastructures standards pour permettre à tout internaute de posséder une identité numérique unique, sécurisée et interopérable.
À long terme, cette évolution pourrait transformer la manière dont nous naviguons sur internet.
Au lieu de remplir des formulaires, de confirmer nos emails ou de gérer des dizaines de mots de passe, nous pourrons simplement signer numériquement pour prouver qui nous sommes. Les sites web, eux, n’auront plus à stocker ni à protéger des bases de données sensibles, ce qui réduira considérablement les risques de fuites ou de piratages.
L’identité numérique Web3 n’est pas seulement une technologie : c’est une philosophie de confiance, de liberté et de responsabilité individuelle. Elle redonne à chacun le contrôle de son image, de ses informations et de sa réputation en ligne.
Les limites et les défis d’une intégration Web3
Le fossé technologique : un obstacle encore réel
Si le Web3 promet un avenir plus équitable et plus sûr pour les utilisateurs, il n’en reste pas moins complexe à mettre en œuvre, surtout pour les développeurs de sites web traditionnels.
Le premier défi réside dans la complexité technique.
Intégrer une fonction Web3 sur un site classique demande une compréhension solide des smart contracts, de la cryptographie et des blockchains publiques. Cela suppose également de manipuler des bibliothèques spécifiques (comme Web3.js ou Ethers.js) et d’adapter la logique serveur pour gérer des interactions asynchrones entre le navigateur et la blockchain.
Pour un site PHP ou WordPress, par exemple, cela peut paraître intimidant. Il faut apprendre à communiquer avec des réseaux décentralisés, à vérifier des signatures numériques et à gérer des transactions parfois longues à confirmer.
Même si des solutions “clé en main” comme WalletConnect, Moralis ou Thirdweb simplifient grandement l’intégration, elles nécessitent tout de même un certain niveau de compréhension pour être utilisées de manière sécurisée et performante.
C’est pourquoi beaucoup de sites web classiques hésitent encore à franchir le pas. L’écosystème Web3 évolue vite, mais il manque encore de standards simples et universels, comparables aux protocoles bien établis du Web2 comme OAuth ou HTTPS.
La barrière de l’expérience utilisateur
Au-delà de la technique, l’un des plus grands défis du Web3 reste l’expérience utilisateur.
Dans le Web2, se connecter à un site est devenu une routine fluide : on saisit un email, un mot de passe ou on clique sur « Se connecter avec Google ».
Dans le Web3, les utilisateurs doivent souvent :
- installer une extension ou une application de portefeuille numérique (comme MetaMask) ;
- gérer une phrase de récupération (seed phrase) qu’ils ne doivent jamais perdre ;
- comprendre les notions de frais de transaction (gas fees) ;
- et accepter que leurs transactions soient publiques et immuables.
Pour les néophytes, ces étapes peuvent sembler décourageantes. Beaucoup abandonnent à la première difficulté, surtout lorsqu’il s’agit de simples interactions avec un site web.
De plus, le vocabulaire du Web3 — “wallet”, “NFT”, “token”, “smart contract” — reste encore intimidant pour le grand public. Si l’objectif est de rendre ces technologies accessibles, il faut absolument simplifier l’interface et éduquer les utilisateurs.
Certaines plateformes l’ont bien compris. Par exemple, Unstoppable Domains et ENS (Ethereum Name Service)permettent d’associer une adresse Web3 à un nom lisible comme votre-nom.crypto, évitant ainsi la complexité des longues adresses hexadécimales.
D’autres projets comme Web3Auth cherchent à combiner la simplicité du Web2 (connexion via Google ou Apple) avec la sécurité du Web3 (signature et propriété décentralisée).
Mais pour l’instant, la majorité des internautes n’a pas encore franchi cette barrière de confort.
Les coûts et la scalabilité
Un autre défi majeur du Web3 concerne les frais de transaction et la scalabilité des blockchains.
Chaque interaction sur une blockchain publique, qu’il s’agisse d’un paiement ou d’une vérification d’identité, nécessite de payer des frais (appelés “gas”). Ces frais sont variables et dépendent de l’encombrement du réseau.
Sur Ethereum, par exemple, le coût d’une simple transaction peut aller de quelques centimes à plusieurs euros selon la période. Pour un site web grand public, qui traite des milliers d’utilisateurs, ces coûts peuvent vite devenir prohibitifs.
Pour pallier cela, de nombreuses solutions dites de Layer 2 (couches secondaires) ont vu le jour : Polygon, Arbitrum, Optimism, ou encore zkSync. Ces réseaux permettent de traiter des transactions plus rapidement et à moindre coût tout en restant sécurisés par la blockchain principale.
Cependant, leur intégration ajoute encore une couche de complexité. Le développeur doit choisir la bonne solution, comprendre ses spécificités et s’assurer de sa compatibilité avec le reste du site.
En parallèle, d’autres blockchains comme Solana ou Avalanche misent sur la vitesse et les faibles coûts pour attirer les applications Web3. Le choix de la bonne technologie devient donc stratégique et demande une veille constante.
Les problématiques environnementales
Le Web3 a souvent été critiqué pour son impact écologique, en particulier à cause du mécanisme de validation appelé Proof of Work (preuve de travail), utilisé historiquement par Bitcoin et, jusqu’en 2022, par Ethereum.
Ce mécanisme consomme énormément d’énergie car il repose sur des calculs cryptographiques intensifs. Toutefois, le secteur a évolué : la plupart des nouvelles blockchains fonctionnent désormais avec le Proof of Stake (preuve d’enjeu), beaucoup plus économe en ressources.
Ethereum, par exemple, a réduit sa consommation énergétique de plus de 99 % après sa transition vers ce modèle. Malgré cela, la réputation du Web3 reste parfois entachée par cette image “polluante”.
Pour un site web classique, il est donc essentiel de choisir une blockchain écoresponsable, si possible basée sur un consensus à faible consommation d’énergie. Polygon, Tezos, ou encore Algorand sont aujourd’hui des exemples de réseaux plus respectueux de l’environnement.
Cette dimension écologique devient un argument important, surtout pour les entreprises qui cherchent à adopter une démarche numérique durable.
Les enjeux légaux et réglementaires
Un autre défi majeur de l’intégration du Web3 concerne la réglementation.
Les blockchains, par nature, sont décentralisées et mondiales. Cela signifie qu’elles échappent en partie aux juridictions nationales.
Mais pour un site web hébergé en Europe, par exemple, il est impossible d’ignorer le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Or, les données inscrites sur la blockchain sont immuables et publiques : une fois enregistrées, elles ne peuvent pas être supprimées, ce qui entre en conflit direct avec le droit à l’oubli.
De même, les micro-paiements ou les programmes de récompense en tokens peuvent être considérés comme des transactions financières. Selon les pays, cela peut impliquer des obligations de déclaration, de fiscalité ou de conformité (KYC/AML).
Les développeurs doivent donc faire preuve de vigilance : le Web3 n’est pas une zone de non-droit. Même si la technologie est décentralisée, les responsabilités légales restent, elles, bien réelles.
C’est pourquoi il est souvent recommandé de :
- utiliser des blockchains compatibles avec les normes de confidentialité ;
- éviter d’enregistrer des données personnelles directement sur la chaîne (préférer un stockage externe, comme IPFS) ;
- et consulter un spécialiste juridique avant de lancer un projet Web3 à vocation commerciale.
Les résistances culturelles et économiques
Enfin, au-delà de la technique et du droit, le Web3 doit faire face à une résistance plus subtile : la culture du Web2.
Depuis des années, les internautes se sont habitués à la gratuité des services et à la centralisation des données. Beaucoup préfèrent céder un peu de leur vie privée plutôt que d’apprendre à gérer eux-mêmes leurs clés ou leurs portefeuilles numériques.
De leur côté, les grandes entreprises du Web2 n’ont pas forcément intérêt à promouvoir un modèle où les utilisateurs contrôlent leurs données et où les intermédiaires disparaissent. Le Web3 remet en cause leur modèle économique basé sur la collecte et la monétisation de l’information.
Pour qu’une adoption massive ait lieu, il faudra du temps, de la pédagogie et surtout des cas concrets simples et utiles. C’est en montrant que le Web3 peut améliorer l’expérience quotidienne — par exemple avec des paiements instantanés, des identités portables ou des contenus mieux rémunérés — que la transition s’accélérera.
Comment les développeurs peuvent s’adapter
Malgré ces obstacles, il est tout à fait possible pour un développeur ou un entrepreneur de commencer petit.
L’idée n’est pas de transformer son site du jour au lendemain en une application décentralisée complète, mais d’expérimenter progressivement.
Un site peut par exemple :
- ajouter une connexion via wallet sans changer le système d’authentification principal ;
- proposer des récompenses symboliques en tokens pour certaines actions ;
- ou encore publier certains certificats ou badges sur une blockchain publique.
Ces petites étapes permettent de tester les réactions des utilisateurs, de comprendre les implications techniques et d’évaluer la valeur ajoutée réelle du Web3 dans un contexte donné.
L’évolution vers le Web3 n’est pas un sprint, mais une transition progressive, que chaque projet peut aborder à son rythme, selon ses besoins et ses moyens.
Web3 et sites web classiques, une révolution à portée de main
Au terme de ce tutoriel, vous avez pu découvrir comment un site web traditionnel peut exploiter les technologies du Web3 pour améliorer l’expérience utilisateur, renforcer la sécurité, et créer de nouvelles sources de valeur. Nous avons exploré trois axes principaux : la vérification et l’authentification Web3, les micro-paiements pour le contenu, et l’identité numérique et la réputation décentralisée.
Le Web3 ne se limite pas aux cryptomonnaies ou aux NFT. Il s’agit avant tout d’un nouveau paradigme pour la gestion de la confiance, de la valeur et de l’identité en ligne. Pour un site classique, adopter le Web3 peut signifier : permettre à vos utilisateurs de se connecter sans mot de passe, rémunérer équitablement les créateurs pour chaque interaction, ou offrir des certificats et des badges infalsifiables. Ces fonctionnalités peuvent transformer un site simple en une plateforme moderne, transparente et interactive, tout en restant compatible avec votre infrastructure existante.
Cependant, cette transition comporte également des défis. L’intégration du Web3 exige une compréhension technique des smart contracts, de la blockchain et des wallets, ainsi qu’une attention particulière aux aspects légaux et réglementaires. L’expérience utilisateur doit être soigneusement pensée, car la complexité des outils Web3 peut rebuter le grand public. Enfin, il faut choisir judicieusement la blockchain pour équilibrer coût, vitesse, sécurité et impact écologique.
Malgré ces obstacles, les bénéfices sont tangibles. La décentralisation réduit les risques de fuite de données, la monétisation devient directe et équitable grâce aux micro-paiements, et la réputation numérique devient portable et vérifiable, offrant aux utilisateurs un contrôle inédit sur leur identité en ligne. Les sites qui adoptent progressivement ces technologies se positionnent en pionniers d’un internet plus juste et plus durable.
Pour aller plus loin, il est conseillé de commencer par des petites expérimentations : ajouter une connexion Web3 sur une partie du site, proposer un paiement symbolique pour un contenu premium, ou délivrer un badge de certification sur la blockchain. Ces premières étapes permettent de se familiariser avec le Web3, d’évaluer sa valeur ajoutée et de préparer votre site à une intégration plus complète à l’avenir.
En conclusion, le Web3 n’est pas seulement une évolution technologique, c’est une opportunité stratégique pour les sites web classiques : renforcer la confiance, améliorer l’expérience utilisateur, monétiser de manière plus directe et sécurisée, et créer un internet plus transparent et équitable. Les développeurs et entrepreneurs qui sauront adopter ces principes dès aujourd’hui seront à l’avant-garde de la prochaine génération du web.
Avec patience, pédagogie et curiosité, chaque site peut intégrer progressivement ces innovations et tirer pleinement parti du potentiel révolutionnaire du Web3.
Chapitre 9. Lire et écrire sur la Blockchain
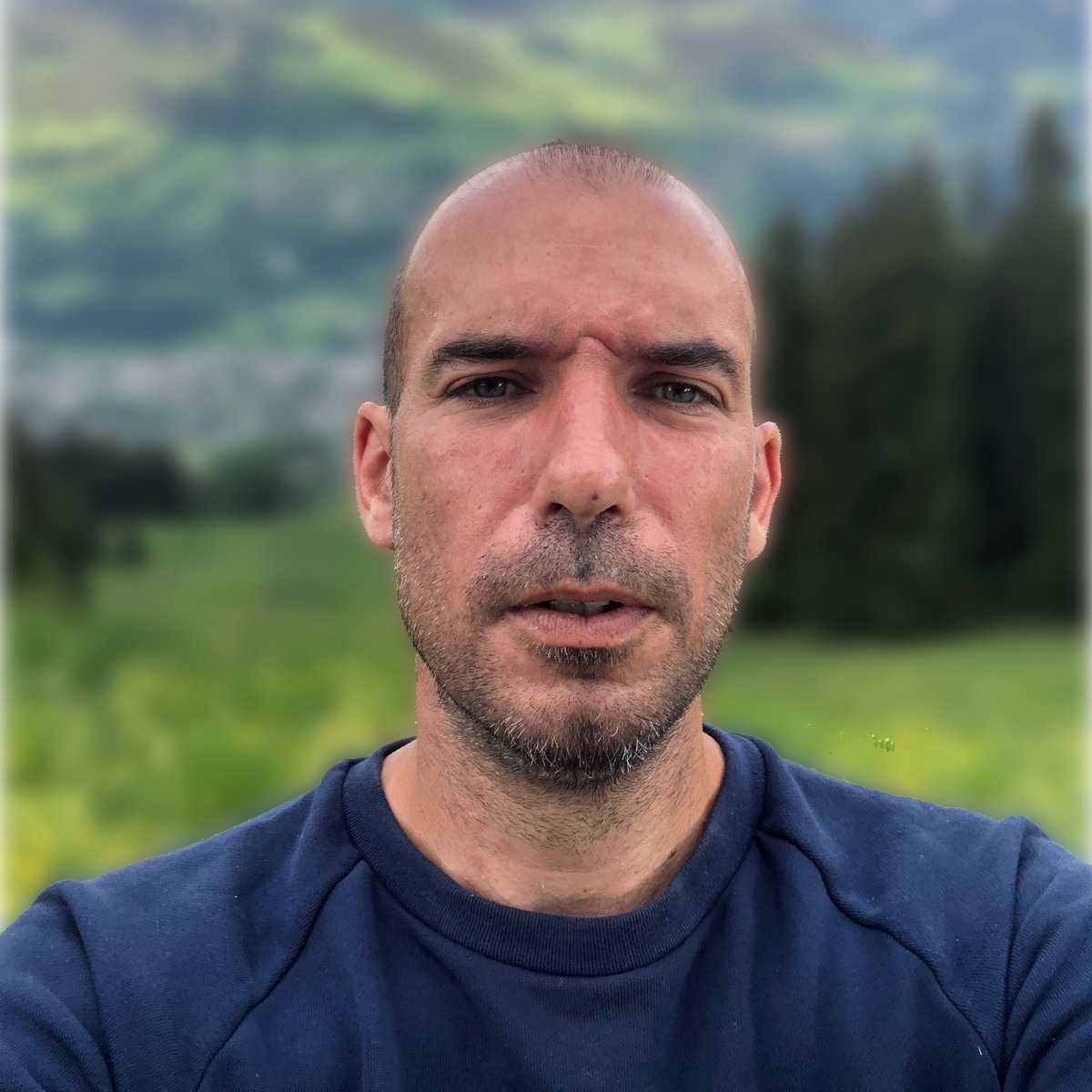
Fondateur de l’agence Créa-troyes, affiliée France Num
Intervenant en Freelance.
Contactez-moi
