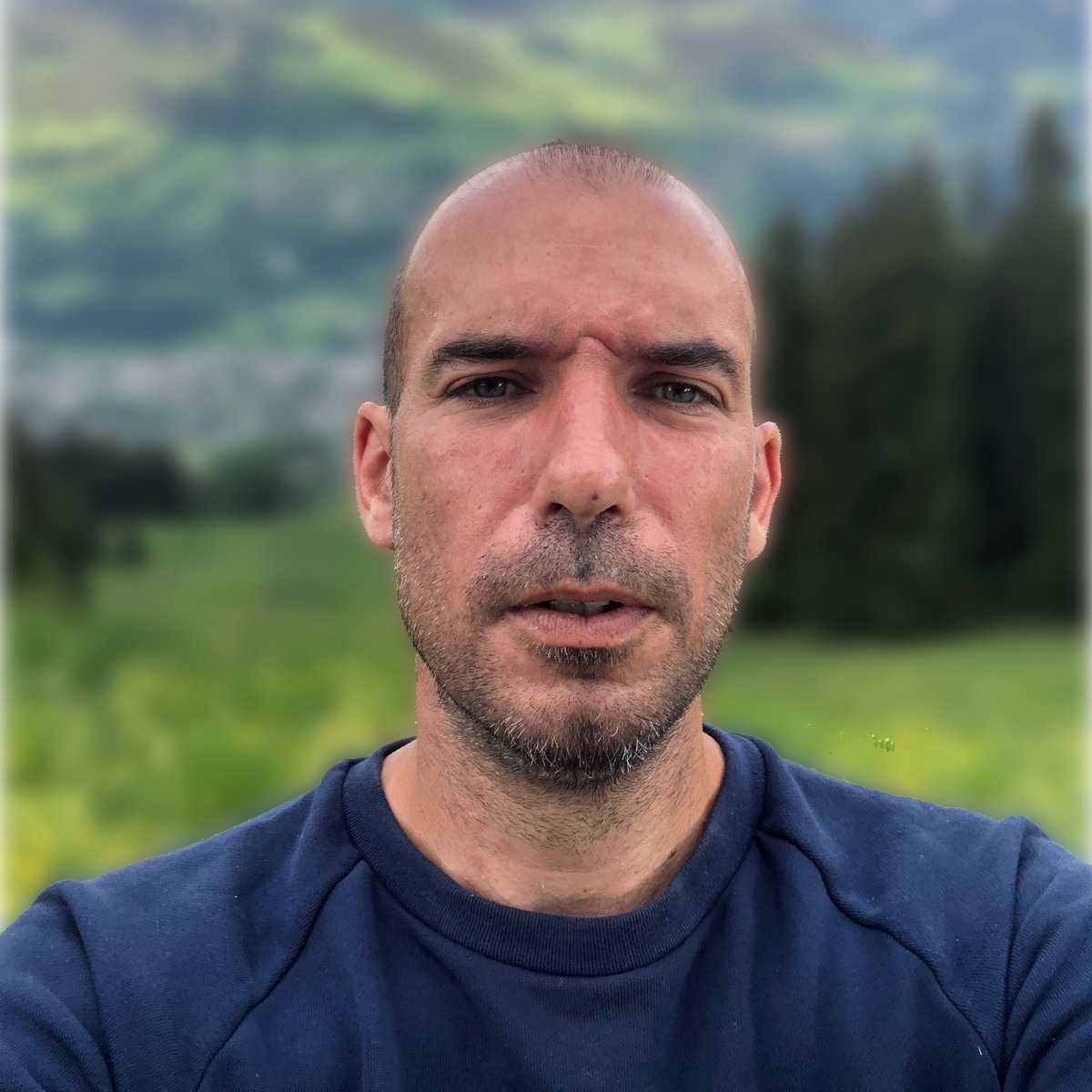Dans le monde du développement web, les mathématiques ne sont pas toujours au cœur de nos préoccupations quotidiennes. On code des sites, on structure des bases de données, on intègre du JavaScript, du PHP ou du CSS. Pourtant, derrière certaines technologies modernes – et notamment l’intelligence artificielle et le deep learning – se cachent des concepts mathématiques essentiels.
Les dérivées et les gradients font partie de ces notions fondamentales. Même si elles semblent abstraites à première vue, elles jouent un rôle capital dans les algorithmes d’apprentissage automatique. Comprendre ces concepts, même sans être mathématicien, vous permettra non seulement de mieux appréhender le fonctionnement du deep learning, mais aussi de voir comment les mathématiques peuvent servir concrètement dans le domaine du développement.
Dans ce chapitre, nous découvrirons ensemble ce qu’est une dérivée, ce qu’est un gradient, et surtout comment ces outils sont utilisés pour optimiser les réseaux de neurones et permettre à une machine « d’apprendre ».
Prenez le temps de suivre chaque explication pas à pas. L’objectif n’est pas de tout retenir par cœur, mais de comprendre le sens logique de chaque étape.
- Pourquoi parler de mathématiques en développement web ?
- Les dérivées : comprendre le changement
- Les dérivées dans l’apprentissage automatique
- Comprendre les dérivées en mathématiques
- Le gradient : une généralisation à plusieurs dimensions
- Comment une machine apprend réellement
- Le rôle des dérivées dans la rétropropagation (backpropagation)
- Un exemple concret en Python pour comprendre
- De la théorie à la pratique : quand les développeurs web croisent le deep learning
- Les limites et défis de la descente de gradient
Pourquoi parler de mathématiques en développement web ?
Avant de plonger dans les dérivées, il est important de comprendre pourquoi un développeur web pourrait s’intéresser aux mathématiques, et en particulier à celles du deep learning.
Depuis quelques années, le web évolue vers des applications de plus en plus intelligentes. On retrouve des chatbots capables de répondre aux utilisateurs, des systèmes de recommandation sur les sites e-commerce, des moteurs de recherche sémantiques, des filtres d’images automatisés ou encore des outils de détection de fraude. Ces technologies reposent sur des modèles d’intelligence artificielle, souvent construits grâce au deep learning.
En tant que développeur, vous pouvez être amené à intégrer ces modèles dans une application, à les entraîner, ou tout simplement à comprendre leur fonctionnement pour mieux les exploiter.
Or, au cœur de chaque modèle d’IA, il existe un mécanisme d’optimisation. Ce mécanisme ajuste les paramètres internes du modèle pour qu’il donne des résultats toujours plus précis. Et cette optimisation repose justement sur… les dérivées et les gradients.
Autrement dit, sans dérivées, pas d’apprentissage automatique. Comprendre ce principe, c’est poser les bases pour comprendre comment une machine apprend à partir de données.
Pour aller plus loin, consultez notre Tutoriel complet sur le Machine learning.
Les dérivées : comprendre le changement
L’idée intuitive d’une dérivée
Pour bien comprendre ce qu’est une dérivée, imaginons un exemple simple et concret.
Supposons que vous conduisiez une voiture. Si on note la distance parcourue en fonction du temps, on peut dire que votre vitesse est la variation de la distance par rapport au temps. Si vous parcourez 100 kilomètres en 2 heures, votre vitesse moyenne est de 50 km/h.
Cette notion de « variation » est exactement ce que mesure une dérivée.
Dans le langage mathématique, la dérivée représente la vitesse de changement d’une variable par rapport à une autre. Elle indique à quelle vitesse une quantité évolue à un instant précis.
Une vision graphique
Prenons une fonction très simple : f(x) = x²
Cette fonction représente une courbe en forme de U. Si vous tracez cette courbe, la dérivée de f(x) en un point donné x indique la pente de la tangente à la courbe en ce point.
Autrement dit :
- Si la dérivée est positive, la courbe monte.
- Si la dérivée est négative, la courbe descend.
- Si la dérivée est nulle, la pente est horizontale : c’est souvent un point de minimum ou de maximum.
Par exemple, pour f(x) = x², la dérivée est f’(x) = 2x.
Cela signifie que :
- Quand x est négatif, la pente est négative (la courbe descend).
- Quand x est positif, la pente est positive (la courbe monte).
- Quand x = 0, la pente est nulle : la courbe atteint son minimum.
Ce concept de minimum va devenir fondamental lorsque nous aborderons l’optimisation dans le deep learning.
Les dérivées dans l’apprentissage automatique
Dans un réseau de neurones, le but est d’ajuster des paramètres (qu’on appelle souvent des poids) pour que le modèle fasse le moins d’erreurs possibles.
Pour mesurer cette erreur, on utilise une fonction appelée fonction de coût ou fonction de perte. Cette fonction indique à quel point les prédictions du modèle sont proches ou loin de la vérité. Le rôle du deep learning est donc de minimiser cette fonction de coût.
Mais comment savoir dans quelle direction ajuster les paramètres pour que la perte diminue ? C’est ici que les dérivées interviennent.
Prenons une image simple : imaginez une montagne avec des bosses et des vallées. Vous êtes en haut d’une colline et votre objectif est de descendre jusqu’à la vallée la plus basse. Si vous aviez une carte indiquant la pente du terrain sous vos pieds, vous pourriez savoir dans quelle direction descendre pour aller vers le bas.
La dérivée, c’est exactement cela : elle indique la direction dans laquelle la fonction augmente ou diminue. En suivant cette pente négative, vous vous rapprochez du minimum.
Dans un modèle d’IA, c’est la même idée : la dérivée de la fonction de perte par rapport à chaque paramètre nous indique comment ajuster ce paramètre pour que la perte diminue.
Comprendre les dérivées en mathématiques
Avant d’utiliser les dérivées dans le monde de l’intelligence artificielle, prenons le temps de comprendre ce qu’elles signifient réellement en mathématiques. Si vous n’avez jamais été à l’aise avec ce concept, pas de panique : on va le découvrir ensemble.
Qu’est-ce qu’une dérivée, concrètement ?
Reprenons notre exemple précédent. Imaginez que vous marchez sur une route qui monte et descend, un peu comme une colline. À chaque instant, votre position sur la route correspond à une valeur de x (la distance parcourue), et la hauteur de la route à cet endroit correspond à une valeur de y.
En d’autres termes, on a une fonction qui relie x à y. Par exemple :
- x = la position,
- y = la hauteur.
Si vous avancez d’un pas, la hauteur change : c’est cette variation qu’on veut mesurer. La dérivée indique à quelle vitesse y change quand x change. Autrement dit :
- si la route monte, la dérivée est positive,
- si elle descend, la dérivée est négative,
- si elle est plate, la dérivée vaut zéro.
La dérivée, c’est donc la pente instantanée de la courbe.
Différence entre moyenne et instantanée
Prenons un autre exemple simple : vous partez en vélo. Vous parcourez 30 kilomètres en 2 heures. Votre vitesse moyenne est de 15 km/h. Mais votre vitesse instantanée n’est pas toujours 15 km/h. Vous accélérez, vous freinez, etc.
La dérivée, c’est ce qui permet de calculer la vitesse instantanée à chaque moment précis. C’est la même chose pour une fonction : elle permet de savoir comment et à quelle vitesse la valeur change à un point donné.
Une première approche visuelle
Imaginons une courbe qui représente la fonction f(x). Si vous tracez une tangente (une droite qui touche la courbe sans la couper) en un point donné, la pente de cette tangente est la valeur de la dérivée en ce point.
Sur une fonction f(x) = x², par exemple :
- la courbe monte lentement à gauche,
- très fort à droite,
- et est plate en x = 0.
Mathématiquement, la dérivée de x² est 2x. Cela signifie :
- à gauche de 0, 2x est négatif → la courbe descend,
- à droite de 0, 2x est positif → la courbe monte,
- à x = 0, 2x = 0 → la courbe est plate.
La formule du taux de variation
Pour comprendre comment on calcule une dérivée, commençons avec la notion de taux de variation moyen. Prenons une fonction f(x). On regarde deux points proches, x et x + h. Le taux de variation moyen entre ces deux points est :
Taux de variation = [ f(x+h)−f(x) ] / h
Ce calcul mesure la pente moyenne entre les deux points.
Mais pour connaître la pente exacte à un point, on rapproche les deux points au maximum (autrement dit, on fait tendre h vers 0).
La dérivée est donc définie comme :
f′(x)= lim (h→0) [ f(x+h)−f(x) ] / h
C’est simplement la version « instantanée » de la pente moyenne.
Exemple pas à pas : dérivée de f(x) = x²
Calculons cette dérivée ensemble.
- On applique la formule : f(x+h) = (x+h)² = x² + 2xh + h²
- On remplace dans la formule : [ f(x+h)−f(x) ] / h = [ (x2+2xh+h2)−x2 ] / h
- On simplifie : = (2xh + h2) / h = 2x+h
- On fait tendre h vers 0 : f′(x) = 2x
Cela veut dire que pour la fonction f(x) = x², la pente dépend de x :
- si x = 2, la pente vaut 4,
- si x = 1, la pente vaut 2,
- si x = 0, la pente vaut 0.
Dérivée d’une droite : cas le plus simple
Si votre fonction est f(x) = 3x + 2, c’est une droite. Une fonction affine, de la forme f(x) = ax + b est toujours sous forme de droite. Le coefficient directeur (a) indique si cette droite est croissante ou décroissante.
Sa pente est constante : elle monte de 3 unités quand x augmente de 1. La dérivée de cette fonction est donc constante et vaut 3. C’est d’ailleurs une bonne façon de comprendre le rôle d’une dérivée : elle mesure la variation locale, c’est-à-dire la pente à un endroit donné.
Dérivée d’une fonction plus complexe
Prenons maintenant f(x) = x³.
On peut utiliser la même formule : f′(x) = 3x2
Ici encore, la dérivée donne une idée de la vitesse de changement :
- Quand x est petit, la pente est faible.
- Quand x grandit, la pente augmente rapidement.
C’est pourquoi les courbes comme x³ deviennent de plus en plus raides.
Pourquoi tout cela est important
Comprendre les dérivées n’est pas seulement utile pour faire des calculs. C’est avant tout une façon de comprendre le monde qui change.
Les dérivées servent à :

Des formations informatique pour tous !
Débutant ou curieux ? Apprenez le développement web, le référencement, le webmarketing, la bureautique, à maîtriser vos appareils Apple et bien plus encore…
Formateur indépendant, professionnel du web depuis 2006, je vous accompagne pas à pas et en cours particulier, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez progresser. En visio, à votre rythme, et toujours avec pédagogie.
Découvrez mes formations Qui suis-je ?- mesurer la vitesse (variation du déplacement),
- mesurer l’accélération (variation de la vitesse),
- analyser la croissance d’un site web (variation du trafic dans le temps),
- optimiser un modèle d’IA (variation de la perte quand on modifie les paramètres).
Derrière chaque notion d’ajustement automatique se cache une dérivée.
En résumé :
- Une dérivée mesure la vitesse de variation d’une fonction.
- Elle correspond à la pente de la courbe à un instant donné.
- Elle se calcule grâce à la limite du taux de variation moyen.
- Dans le deep learning, on l’utilise pour savoir comment modifier les paramètres d’un modèle pour qu’il fasse moins d’erreurs.
Le gradient : une généralisation à plusieurs dimensions
Du simple au multiple
Jusqu’ici, nous avons parlé de dérivée d’une seule variable. Mais dans la réalité, un modèle de deep learning ne possède pas une seule variable. Il peut en avoir des milliers, voire des millions. Dans ce cas, on ne parle plus d’une simple dérivée, mais d’un gradient.
Le gradient est un vecteur qui contient toutes les dérivées partielles de la fonction de coût par rapport à chacun des paramètres du modèle. Cela peut sembler compliqué, mais le principe est simple :
- Chaque paramètre influence le résultat final du modèle.
- On calcule donc la dérivée de la perte par rapport à chacun d’eux pour savoir dans quelle direction les ajuster.
Ainsi, le gradient indique la direction de la plus forte augmentation de la fonction. Pour aller vers le minimum, il suffit de prendre la direction opposée.
Exemple concret : descente de gradient
Imaginons que vous essayiez d’ajuster un modèle pour prédire le prix d’une maison à partir de sa surface. Votre modèle prédit un prix, mais il se trompe. Vous calculez alors la fonction de perte, qui mesure l’erreur entre la prédiction et la valeur réelle.
Pour réduire cette erreur, vous calculez la dérivée de la perte par rapport à votre paramètre (le coefficient du modèle). Cette dérivée vous dit dans quelle direction bouger pour améliorer la précision.
Si la dérivée est positive, cela signifie que votre paramètre est trop grand, donc il faut le diminuer. Si elle est négative, il faut l’augmenter.
En ajustant les paramètres dans le sens opposé au gradient, pas à pas, votre modèle apprend à donner de meilleures prédictions. C’est ce qu’on appelle la descente de gradient (gradient descent).
Comment une machine apprend réellement
Le principe général
Reprenons notre analogie de tout à l’heure : vous êtes sur une montagne, et vous cherchez à atteindre la vallée la plus basse possible. Vous ne voyez pas toute la montagne, mais vous savez, grâce à la pente sous vos pieds, dans quelle direction descendre. À chaque pas, vous ajustez votre trajectoire pour continuer à descendre.
La descente de gradient fonctionne exactement sur le même principe.
L’algorithme commence par choisir des valeurs de départ pour les paramètres (souvent aléatoires). Ensuite, il calcule la fonction de perte pour savoir à quel point le modèle est mauvais. Puis il calcule le gradient de cette fonction : autrement dit, la direction dans laquelle la perte augmente le plus rapidement. Pour améliorer le modèle, on fait le pas dans la direction opposée — celle où la perte diminue.
On répète ce processus encore et encore, jusqu’à ce que la fonction de perte soit aussi petite que possible. C’est ainsi qu’un réseau de neurones apprend.
La taille du pas : le taux d’apprentissage
Un détail très important dans ce processus est la taille du pas que vous faites à chaque itération. Ce pas est appelé taux d’apprentissage (learning rate en anglais).
- Si votre pas est trop grand, vous risquez de dépasser le minimum et de remonter de l’autre côté de la vallée.
- Si votre pas est trop petit, vous mettrez une éternité à atteindre le fond.
- Si votre pas est bien calibré, vous convergez rapidement vers la solution optimale.
Trouver un bon taux d’apprentissage est donc un équilibre délicat. En pratique, ce paramètre est souvent réglé expérimentalement.
Les trois grandes variantes de la descente de gradient
Dans la pratique, il existe plusieurs manières d’appliquer la descente de gradient, selon la quantité de données que vous traitez à chaque itération.
a) Batch Gradient Descent
C’est la méthode la plus simple à comprendre. On calcule la perte sur tout le jeu de données d’un coup, puis on met à jour les paramètres une fois.
L’avantage, c’est que le calcul est précis. L’inconvénient, c’est qu’il est très lent quand vous avez des millions de données.
b) Stochastic Gradient Descent (SGD)
Ici, on met à jour les paramètres après chaque exemple. Cela rend l’apprentissage beaucoup plus rapide, car on n’attend pas de traiter tout le jeu de données.
En revanche, cela introduit un peu de « bruit » : les mises à jour sont moins stables, car chaque exemple peut faire varier la direction de la pente. Mais ce bruit peut être bénéfique : il aide parfois à sortir des minima locaux, c’est-à-dire des vallées secondaires qui ne sont pas le point le plus bas globalement.
c) Mini-Batch Gradient Descent
C’est le meilleur des deux mondes. On découpe les données en petits lots (appelés mini-batches). Pour chaque lot, on calcule le gradient et on met à jour les paramètres.
Cette approche est la plus utilisée aujourd’hui, car elle est rapide, stable et s’adapte parfaitement aux calculs sur GPU.
Exemple imagé
Imaginons que vous entraîniez un modèle de deep learning pour reconnaître si une image contient un chat ou non.
- La fonction de perte indique à quel point le modèle s’est trompé.
- Le gradient indique la direction à suivre pour réduire l’erreur.
- Le taux d’apprentissage détermine la vitesse d’ajustement.
- La descente de gradient itère sur des milliers d’images jusqu’à ce que le modèle fasse le moins d’erreurs possible.
Ainsi, les dérivées et gradients deviennent des outils concrets de correction d’erreur : la machine apprend à partir de ses fautes.
Le rôle des dérivées dans la rétropropagation (backpropagation)
Le problème de l’erreur à répartir
Un réseau de neurones profond (deep neural network) est composé de plusieurs couches :
- une couche d’entrée,
- une ou plusieurs couches cachées,
- et une couche de sortie.
Chaque connexion entre les neurones possède un poids, et c’est en ajustant ces poids que le modèle apprend. Mais une question se pose : comment savoir quels poids modifier, et dans quelle proportion ?
C’est ici qu’intervient la rétropropagation du gradient, ou backpropagation.
Principe de la rétropropagation
Le concept est simple, même s’il est mathématiquement dense.
Lorsqu’un réseau de neurones fait une prédiction, on calcule une erreur grâce à la fonction de perte. Cette erreur se trouve à la sortie du réseau. La rétropropagation consiste à faire remonter cette erreur dans le réseau, couche par couche, pour savoir comment chaque poids a contribué à l’erreur finale.
Grâce aux dérivées partielles, on peut mesurer l’impact de chaque paramètre sur la perte totale. Ces dérivées sont ensuite utilisées pour ajuster les poids dans la bonne direction, grâce au gradient.
En clair :
- Le réseau fait une prédiction.
- On calcule l’erreur (la différence entre la prédiction et la vérité).
- On propage cette erreur vers l’arrière grâce aux dérivées.
- On ajuste les poids avec la descente de gradient.
Et on recommence.
Exemple simple de backpropagation
Imaginons un mini-réseau avec une seule entrée, un neurone caché et une sortie. On suppose que le réseau prédit une valeur trop grande. En calculant la dérivée de la perte par rapport au poids, on découvre que si on diminue légèrement ce poids, la perte diminue.
Le réseau ajuste donc le poids en conséquence. Lors du prochain passage (appelé epoch), le modèle fera une prédiction un peu meilleure.
Répétez ce processus des milliers de fois, et le réseau finira par « apprendre » à produire des résultats très précis.
Un exemple concret en Python pour comprendre
Pour rendre cela plus concret, voyons un petit exemple codé en Python, simplifié au maximum. Nous allons modéliser une fonction très simple : y = x², et utiliser la descente de gradient pour trouver la valeur de x qui minimise cette fonction.
# Exemple simple : descente de gradient sur y = x²
x = 10.0 # valeur de départ
learning_rate = 0.1
for i in range(20):
y = x**2 # fonction
dy_dx = 2*x # dérivée de y = x²
x = x - learning_rate * dy_dx # mise à jour
print(f"Iteration {i+1}: x = {x:.4f}, y = {y:.4f}")
Si vous exécutez ce code, vous verrez que x se rapproche progressivement de 0, le minimum de la fonction y = x². Chaque mise à jour correspond à une étape de descente de gradient.
Même si cet exemple est basique, il illustre exactement la logique utilisée dans un réseau de neurones : suivre la pente du gradient pour minimiser une erreur.
De la théorie à la pratique : quand les développeurs web croisent le deep learning
Aujourd’hui, de plus en plus d’applications web intègrent des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Voici quelques cas concrets où la compréhension des dérivées et gradients peut réellement aider un développeur web :
- Optimisation d’images : certains outils utilisent des réseaux de neurones pour compresser des images sans perte visible, en ajustant automatiquement les paramètres via descente de gradient.
- Personnalisation de contenu : les systèmes de recommandation (comme Netflix ou YouTube) s’appuient sur des modèles de deep learning entraînés grâce à ces mêmes principes d’optimisation.
- Chatbots intelligents : les modèles de traitement du langage naturel (NLP) sont optimisés à l’aide de millions de dérivées pour affiner la compréhension des phrases.
- Analyse prédictive : qu’il s’agisse de ventes, de trafic web ou de conversion, les modèles d’apprentissage supervisé utilisent des gradients pour améliorer leurs prédictions au fil du temps.
Même si vous n’êtes pas mathématicien, comprendre cette logique vous permet de mieux collaborer avec les équipes data et de créer des intégrations plus pertinentes dans vos applications web.
Les limites et défis de la descente de gradient
Comme tout algorithme, la descente de gradient a ses limites.
Les minima locaux
Certaines fonctions possèdent plusieurs « vallées ». Si l’algorithme tombe dans une vallée peu profonde, il peut croire avoir trouvé le minimum, alors qu’il existe un point plus bas ailleurs. C’est le problème des minima locaux.
Des variantes comme la descente de gradient avec momentum ou des optimisateurs modernes comme Adam (Adaptive Moment Estimation) permettent d’atténuer ce problème.
Le choix du taux d’apprentissage
Un taux trop grand empêche la convergence, un taux trop faible rend l’apprentissage interminable. Il faut parfois ajuster ce paramètre dynamiquement pendant l’entraînement, ou utiliser des techniques comme le learning rate scheduling.
Le coût computationnel
Calculer des gradients sur des millions de paramètres est une tâche lourde. Heureusement, les GPU et les bibliothèques comme TensorFlow ou PyTorch rendent ces calculs très efficaces aujourd’hui.
Les dérivées et les gradients ne sont pas réservés aux mathématiciens. Ce sont des outils puissants qui permettent aux machines d’apprendre et de s’adapter.
En comprenant ces concepts, même de manière intuitive, vous franchissez une étape essentielle dans votre évolution de développeur. Vous passez du rôle de simple utilisateur de technologies à celui de créateur capable de comprendre comment elles fonctionnent réellement.
Le deep learning n’est finalement qu’une suite logique de calculs simples, répétés des millions de fois. Chaque ajustement, chaque descente du gradient, rapproche la machine d’une meilleure compréhension des données.
Et demain, lorsque vous intégrerez une IA sur un site web, vous saurez que derrière chaque prédiction, chaque recommandation ou chaque reconnaissance d’image, se cache une idée simple : suivre la pente d’une courbe grâce aux dérivées.